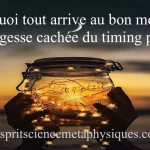La conscience pourrait survivre à la mort
Selon certains scientifiques, une « conscience crépusculaire » pourrait exister chez les patients mourants. Cela soulève une question troublante : et si la mort n’était pas définitive ? Juste avant de cesser de fonctionner, le cerveau pourrait produire un dernier effort pour résoudre un problème non réglé ou trouver une raison de rester en vie.
Une mort moins évidente qu’on ne le croit
La mort n’est peut-être pas un événement instantané et évident. Des études montrent que les ondes cérébrales gamma, associées à la mémoire et à la conscience, peuvent persister même après la disparition d’autres signes de vie. Les expériences de mort imminente suggèrent que le cerveau pourrait tenter désespérément de trouver un sens ou de survivre, remettant en question nos idées traditionnelles sur la fin de la vie.
Des implications pour le don d’organes
Les interprétations erronées de la mort peuvent avoir des conséquences sur des pratiques médicales comme le don d’organes, nécessitant une réévaluation stricte des protocoles. Par exemple, le 26 octobre 2021, au Baptist Health Richmond dans le Kentucky, Anthony « TJ » Hoover II, 36 ans, a été déclaré en état de mort cérébrale après une overdose. Sa famille avait été informée qu’il n’avait plus aucun réflexe ni activité cérébrale, et l’équipe médicale avait commencé les préparatifs pour le don d’organes.
Cependant, environ une heure après le début de l’intervention, les chirurgiens ont interrompu l’opération : Hoover avait commencé à se débattre sur la table. Contre toute attente, il avait repris conscience. Bien qu’il souffre encore de troubles durables de la parole, de la mémoire et de la mobilité liés à son overdose, Hoover a survécu et a été confié aux soins de sa sœur.
Des cas similaires ont été rapportés à travers le monde, du Kenya à la Pologne, de l’Équateur à la Chine, où des personnes se sont réveillées dans des morgues, des cercueils ou lors des derniers sacrements. Ces événements suggèrent que la mort pourrait ne pas être l’événement soudain et définitif que les protocoles médicaux laissent entendre.
Le modèle réductionniste et ses limites

Le modèle scientifique classique considère que la conscience disparaît immédiatement après la mort. Mais de nouvelles études montrent des anomalies qui remettent en question cette chronologie.
Par exemple, des sursauts d’ondes gamma – une activité électrique cérébrale à haute fréquence (30 à 100 hertz) – ont été observés même après la mort. Ces ondes sont du même type que celles liées à la mémoire et à la conscience. Mais pourquoi le cerveau activerait-il de telles ondes juste avant ou juste après la mort ?
Des observations surprenantes
Une étude de l’Université du Michigan a analysé les enregistrements d’électroencéphalogrammes (EEG) et d’électrocardiogrammes (ECG) de quatre patients comateux après l’arrêt des respirateurs. L’EEG mesure l’activité électrique cérébrale, tandis que l’ECG suit le rythme cardiaque.
Chez deux patients, les chercheurs ont observé une augmentation soudaine des ondes gamma quelques secondes après le déclin cardiaque. Ces sursauts n’étaient pas aléatoires : ils étaient synchronisés avec des rythmes cérébraux plus lents, un schéma observé dans la perception consciente et le sommeil paradoxal.
Les chercheurs ont également noté une forte connectivité cérébrale, notamment dans la « zone chaude postérieure », associée à la vision, à la conscience corporelle et au traitement sensoriel. Cette connectivité s’étendait aux régions frontales, reproduisant des schémas neuronaux similaires à ceux observés dans les rêves, les états psychédéliques et la perception consciente.
Une activation cérébrale étonnante après l’arrêt des fonctions vitales

« Il y a eu une activation hautement organisée dans des régions clés du cerveau, comme si le système tout entier s’était momentanément illuminé de l’intérieur », explique Jimo Borjigin, Ph. D., professeur agrégé de neurologie et de physiologie moléculaire et intégrative à l’Université du Michigan et coauteur de l’étude.
Cette activation est apparue dans des zones liées au mouvement, à la parole et même à la jonction temporo-pariétale, une région impliquée dans l’intégration des informations sensorielles et souvent associée aux expériences extracorporelles (EHC), fréquemment rapportées lors d’expériences de mort imminente (EMI).
De nombreux témoignages d’EMI décrivent des phénomènes sensoriels saisissants, comme des lumières vives, des tunnels ou l’audition de voix de proches décédés. Selon Borjigin, ces expériences pourraient être liées aux schémas d’activité observés dans les régions cérébrales impliquées dans la vision et le traitement sensoriel.
Pourquoi un cerveau mourant reste-t-il actif ?
Pourquoi le cerveau mourant s’éteindrait-il avec une activité aussi intense, plutôt qu’avec une lente dérive ? Cela semble coûteux sur le plan biologique. « Le cerveau consomme 20 % de l’énergie du corps », explique Borjigin. « Pourquoi, à cet instant précis, juste après l’arrêt de l’apport en oxygène, déployer autant d’efforts pour produire une expérience consciente ? »
Elle avance une hypothèse : le cerveau pourrait se lancer dans une quête intérieure de survie. De nombreuses personnes ayant vécu des EMI rapportent revivre des moments émotionnels, entendre des messages comme « Ce n’est pas ton heure » ou voir des proches décédés. Le cerveau mourant pourrait puiser profondément dans la mémoire à la recherche d’un but non résolu ou d’une raison impérieuse de continuer à vivre.
Une conscience crépusculaire

Borjigin souligne que ces observations remettent en question nos idées reçues. « Nous considérons une personne comateuse comme ‘partie’, mais même dans ces états, une activité gamma organisée apparaît dans les régions liées à la perception visuelle. C’est une sorte de conscience crépusculaire, peut-être cachée, mais active. »
Elle rappelle que dans l’étude, quatre patients étaient dans le coma, inconscients, et que les médecins pensaient qu’il n’y avait plus d’espoir et voulaient retirer les respirateurs. Pourtant, chez deux d’entre eux, une activité cérébrale massive a persisté. Cela devrait nous inciter à repenser le processus de la mort, car celle-ci ne signifie peut-être pas la fin de la vie.
Cette incertitude pourrait influencer la manière dont les chirurgiens évaluent le moment du don d’organes. Si les signes de vie cachés ne sont pas reconnus, il existe un risque de prélever des organes sur une personne qui aurait pu survivre. Borjigin précise que ces cas restent extrêmement rares et que le don d’organes sauve néanmoins d’innombrables vies.
Une mort plus ambiguë qu’on ne le pense
Selon Caroline Watt, Ph. D., professeure émérite de parapsychologie à l’Université d’Édimbourg, « un arrêt cardiaque ne signifie pas nécessairement la mort, car l’activité cérébrale peut persister ». Certains EEG, notamment ceux utilisés en dehors de la recherche, peuvent ne pas détecter les signaux subtils. De plus, de nombreux décès surviennent hors des hôpitaux, où aucune surveillance cérébrale n’est réalisée, laissant cette ambiguïté sans réponse.
Des avis scientifiques divergents
Tout le monde n’est pas convaincu par les interprétations des récentes études du Michigan. Le Dr Bruce Greyson, professeur émérite de psychiatrie et de sciences neurocomportementales à l’Université de Virginie et cofondateur de l’Association internationale pour les études sur la mort imminente (IANDS), souligne que ces études donnent matière à réflexion, mais restent loin d’être concluantes.
Selon lui, dans les cas étudiés au Michigan, le cœur battait encore et l’oxygène circulait. Ce seul fait, affirme-t-il, exclut que l’on puisse considérer ces données comme post-mortem. De plus, aucun des patients n’est revenu à la vie, ce qui rend impossible toute corrélation certaine entre les pics d’ondes gamma et les expériences de mort imminente (EMI). « Cela ne prouve pas que l’activité gamma soit un marqueur des EMI, mais plutôt le contraire », explique Greyson. Selon lui, ces pics pourraient résulter de douleurs, de spasmes, ou même d’un bruit électrique provenant des muscles.
Les EMI et la conscience

Dans son livre After: A Doctor Explores What Near-Death Experiences Reveal About Life and Beyond, Greyson soutient que les EMI suggèrent que la conscience ne peut pas être entièrement réduite aux fonctions cérébrales, remettant en question les modèles strictement matérialistes de l’esprit. Comme il le note en citant Parnia (2024) : « La question de la conscience et de sa relation avec le cerveau demeure l’un des plus grands mystères de la science. »
Bien que Greyson ne prétende pas que les EMI prouvent que la conscience survit à la mort, il reconnaît qu’elles soulèvent des questions importantes sur les modèles de conscience basés sur le cerveau. Borjigin partage ce point de vue : « La mort est la plus grande maladie que personne n’ait étudiée. »
Des cas étonnants de réanimation après déclaration de décès
Certains cas historiques semblent confirmer la possibilité d’une « résurrection » après une déclaration de mort. En 2012, Li Xiufeng, 95 ans, originaire de la province du Guangxi en Chine, a été déclarée morte par ses voisins après une chute. Son corps est resté dans un cercueil ouvert pendant six jours, comme le voulait la tradition, jusqu’à ce qu’elle sorte quelques heures avant les funérailles pour aller préparer à manger. « J’ai dormi longtemps. Au réveil, j’avais très faim et j’avais envie de cuisiner quelque chose », a-t-elle raconté.
Repenser nos connaissances sur la mort
Interrogée sur la possibilité que des personnes aient été enterrées vivantes ou réanimées après une déclaration erronée de décès, Borjigin ne nie pas cette éventualité. Elle suggère même une solution audacieuse : « Peut-être devrions-nous installer une caméra dans un cercueil. »
Elle insiste sur la nécessité d’une réévaluation scientifique mondiale : « Nous avons besoin de preuves concrètes de ce à quoi ressemble la mort, pas seulement de garanties culturelles ou religieuses. La mort est la maladie que tout le monde va attraper, et pourtant nous en savons si peu. »