
L’importance de perdre du temps
Dans une culture qui valorise chaque instant, perdre du temps peut pourtant apporter paix et soulagement. Quand j’étais adolescent, je passais tout mon temps libre à jouer à des jeux vidéo. Principalement à League of Legends, mais aussi à Call of Duty, Age of Empires ou Minecraft. Ce n’était pas un passe-temps occasionnel, c’était une obsession. Je rentrais de l’école, jetais mon sac à dos dans un coin, allumais mon ordinateur et jouais souvent tard le soir. L’école passait alors au second plan.
Le sentiment de retard
En grandissant et en jouant de moins en moins, je me sentais de plus en plus en retard sur les autres. Certains avaient passé leur adolescence à sortir, vivre des expériences, se découvrir et tisser des relations. Et puis il y avait moi, qui avais passé ma jeunesse à diriger des personnages virtuels dans des mondes imaginaires.
Au total, j’ai dû passer plus de dix mille heures à jouer aux jeux vidéo. Dix mille heures, soit 20 heures par semaine pendant dix ans, ou 40 heures par semaine pendant cinq ans. Dix mille heures, c’est également le temps théorique nécessaire pour maîtriser une compétence, selon certaines études controversées. Si je n’avais pas joué, j’aurais pu apprendre le violon, écrire un livre ou m’entraîner pour devenir cycliste professionnel.
Mais je ne l’ai pas fait. Et comme le dentifrice, le temps ne peut pas être remis dans son tube. À première vue, ces dix mille heures semblaient perdues.
Une nouvelle obsession : YouTube

Après les jeux vidéo, YouTube est arrivé. C’est là que j’ai découvert Casey Neistat, un créateur qui publiait des vidéos quotidiennement tout en gérant son entreprise, sa famille et ses marathons.
Une vidéo en particulier m’a marqué. Casey y parle de gestion du temps. Il cite Sénèque et insiste sur le fait que le temps est sa ressource la plus précieuse. Il explique qu’il essaie de ne jamais perdre une seconde. Selon lui, le seul moment où il se sent vraiment déprimé, c’est lorsqu’il n’est pas productif, lorsqu’il n’accomplit rien, lorsqu’il ne contribue à rien. Rien ne le rend moins heureux que de rester assis sans rien faire.
La journée type de Casey Neistat
Casey décrit comment il structure sa journée en six grandes catégories : temps libre, sommeil, travail, sport, famille et loisirs. Voici sa journée type, qui semble presque impossible à tenir :
- Exercice : 3 heures
- Travail : 14 heures
- Famille : 3 heures
- Sommeil : 4 heures
- Temps libre : 0 heure
- Amusement : 0 heure
Cette discipline m’a impressionné, mais elle m’a aussi fait réfléchir sur ce que signifie vraiment perdre du temps et sur la valeur du repos et de l’oisiveté.
La culpabilité face au temps
La vidéo m’a profondément marqué. Je me souviens surtout du sentiment de culpabilité que je ressentais, car contrairement à Casey, je ne consacrais pas mon temps à des activités enrichissantes. Je passais mes journées à regarder YouTube. Cette idée que le temps est une ressource que l’on peut maîtriser, que l’on peut « gagner » chaque jour à condition de s’y mettre sérieusement, m’a intrigué.
Le projet « Perdre du temps »

Je me suis lancé dans ce que j’ai appelé le projet « Perdre du temps ». Rapidement, mes journées ont commencé à ressembler à celles de Casey. Je me levais, faisais une heure de sport, travaillais dix heures, rentrais à pied, retravaillais deux heures, puis dormais. Tout tournait autour du travail. Même dans mes moments de repos, je me dépêchais de me ressourcer pour pouvoir recommencer et travailler encore plus.
C’était ma vie. Et pourtant, ironiquement, j’avais toujours l’impression de ne pas en faire assez. J’écrivais un article, lisais un livre, avais une bonne conversation, et me disais : « Ce n’est pas possible, il doit y avoir mieux. » Je ne profitais jamais vraiment de mon temps.
Je suis devenue très sensible à chaque seconde « non productive », me sentant obligée de les transformer en efforts plus fructueux. Quand je me surprenais allongée dans mon lit à utiliser mon téléphone, la frustration et la culpabilité me submergeaient. Je me reprochais de ne pas progresser, de ne pas créer, de ne pas contribuer.
L’illusion du contrôle
Je me souviens d’un soir en particulier, debout au sommet d’une montagne, contemplant la vallée et le plus beau coucher de soleil. Des traînées orange et violettes perçaient les nuages. Une brise chaude caressait mes joues, les grillons chantaient au loin, le parfum de la lavande flottait dans l’air.
Ce dont je me souviens le plus, c’est l’intensité avec laquelle j’ai essayé de tout refouler. J’étais trop consciente de la rapidité avec laquelle ce moment passerait. Je voulais en profiter, le savourer, le faire durer, le faire durer, le faire durer. Paradoxalement, chaque fois que j’essayais de transformer le temps en accomplissement, je ne faisais que gagner agitation, inutilité et anxiété.
Je ne gérais pas mon temps. C’était le temps qui me gérait.
L’impasse du Projet « Pas de Temps »
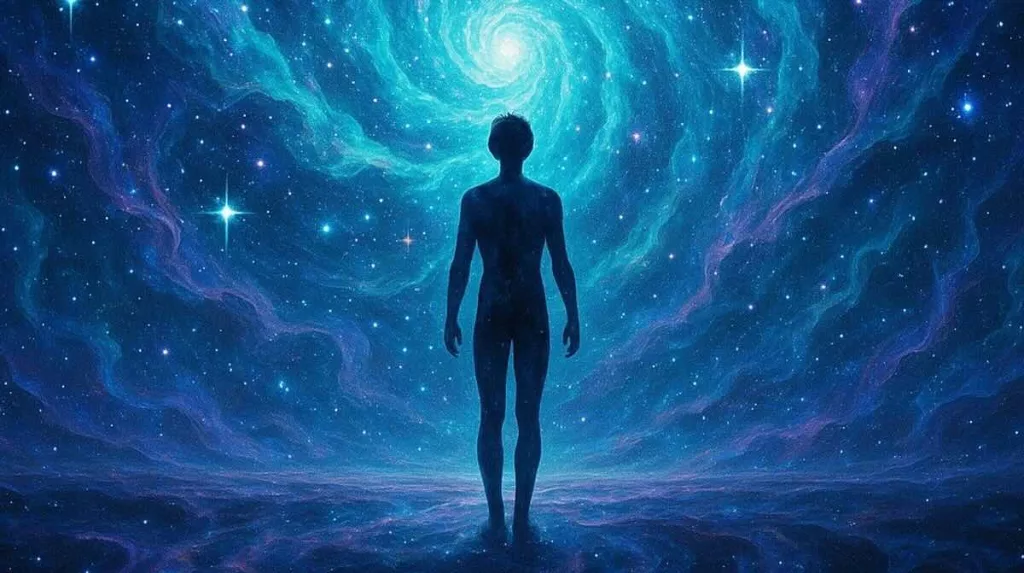
D’une manière étrange et perverse, ce projet m’a laissé tomber sur les deux fronts. Les activités « fainéantes » me faisaient regretter, car je n’étais pas productive. Les activités « productives » me faisaient angoisser, car rien ne me semblait assez bien. Je cherchais constamment un état futur : un objectif, une étape importante, un sentiment de bonheur. Et pourtant, dans les rares moments où j’atteignais ces états, le grain de sable de la satisfaction me filait entre les doigts.
L’ironie était presque comique. Plus je pensais au temps perdu, plus je vivais dans le passé. À l’inverse, plus je pensais à ne pas perdre de temps, plus je vivais dans l’avenir. L’ironie, c’est que je n’ai jamais vécu le présent.
La seule façon de sortir de cette impasse, je suppose, est de faire un geste qui pourrait sembler horriblement bizarre dans notre société post-industrielle : accepter de ne rien faire.
Aussi étrange que cela puisse paraître, perdre son temps est un art qui peut être maîtrisé, tout comme préparer de délicieux gâteaux ou dessiner des croquis photoréalistes. Dans de nombreuses traditions bouddhistes, perdre son temps est même un rituel important.
Les mandalas de sable
Le bouddhisme tantrique, par exemple, pratique la cérémonie poignante de la construction de mandalas de sable. Pendant des centaines d’heures, les moines placent soigneusement des millions de grains de sable colorés pour créer une œuvre d’art géante aux motifs et images complexes. Une fois le mandala terminé, les moines le détruisent en balayant le sable vers le centre jusqu’à ce qu’il ne reste qu’un tas de poussière colorée.
Les partisans du néolibéralisme pourraient intervenir à ce stade en s’exclamant : « Attendez ! Ne le détruisez pas ! Vous pourriez vendre ça comme de l’art ! » Mais le but des mandalas réside précisément dans leur impermanence, leur futilité, leur inutilité.
Comme le souligne le philosophe australien WD Joske, « l’inutilité même d’une activité peut contribuer à son plaisir, la rendant plus véritablement ludique. »
La valeur du temps
Nous avons tous une idée préconçue de ce qui est considéré comme du temps perdu et de ce qui ne l’est pas. Pour moi, c’est l’idée que le temps n’est bien utilisé que s’il crée de la valeur future. Chaque seconde doit avoir sa valeur. Et pourtant, cette hypothèse est absurde à plusieurs niveaux.
Si tout doit avoir une valeur, il faut un but ultime qui justifie toutes ces activités. Certains objectifs peuvent être de gagner de l’argent, d’acquérir de la notoriété ou d’être heureux. Mais chaque fois que j’essayais d’adopter l’un de ces objectifs, je me demandais : « Et à quoi ça sert ? »
Les moments inutiles

D’un point de vue empirique, cette logique est également erronée. Je ne me suis jamais senti pleinement en paix en travaillant. Les rares moments de véritable sérénité se produisaient lorsque je ne poursuivais aucun objectif professionnel, ne faisais rien d’utile, ne cherchais pas à atteindre une fin. Ces moments paisibles étaient plutôt des moments « inutiles » : m’asseoir sur un banc public, marcher dans une forêt dense ou m’étendre paresseusement dans un pré.
Cela ne signifie pas que toutes les actions tournées vers l’avenir sont futiles. Elles sont nécessaires et apportent beaucoup de plaisir. Et pourtant, je suis convaincu que gaspiller une partie de ma vie est le seul moyen de ne pas la gaspiller. Si je n’avais pas « perdu » dix mille heures à jouer à des jeux vidéo, je n’aurais peut-être jamais découvert ce qui est important pour moi aujourd’hui. J’aurais peut-être aussi eu beaucoup moins de plaisir à l’adolescence. Qui sait ? J’aime à penser que tout cela était nécessaire.
L’essentiel est que le temps n’est pas une ressource à dépenser, mais une réalité à vivre. Le temps n’est pas quelque chose que nous pouvons gaspiller, dépenser, accumuler ou posséder. Bien au contraire, c’est quelque chose que nous sommes. De ce point de vue, gaspiller son temps – exister sans but – revêt une importance cosmique. C’est une nécessité.
En y réfléchissant maintenant, je devrais vraiment arrêter d’écrire ces lignes et perdre un peu de mon temps précieux.

