
La science derrière le phénomène de suivre la foule
Il peut sembler que nous maîtrisions pleinement nos pensées et nos comportements. Pourtant, la psychologie sociale raconte une toute autre histoire. La psychologie sociale est définie comme l’étude scientifique de la manière dont nous pensons, influençons et interagissons avec les autres. En tant qu’êtres sociaux, nous passons une grande partie de notre temps éveillé à communiquer et à observer ceux qui nous entourent. Cette proximité constante avec les autres a un impact profond sur nos décisions et nos croyances.
L’influence des autres sur nos comportements
L’un des enseignements clés de la psychologie sociale est l’influence que les autres exercent sur nous. Les recherches montrent que nous n’avons pas toujours autant de contrôle sur nos pensées et nos actions que nous le pensons. Nous nous inspirons constamment de notre environnement et des personnes qui nous entourent pour orienter nos comportements.
Par exemple, dans les files d’attente, les gens ont tendance à suivre la manière dont les autres se positionnent, même si elle n’est pas optimale. Dans les réseaux sociaux, les opinions populaires peuvent rapidement façonner nos propres croyances, parfois sans que nous en soyons conscients.
Comment les groupes modifient nos opinions
La polarisation de groupe
Un concept central en psychologie sociale est la polarisation de groupe. Elle décrit le phénomène par lequel les individus ayant des opinions similaires voient leurs convictions renforcées lorsqu’ils discutent en groupe.
Une étude classique menée par les psychologues français Serge Moscovici et Marisa Zavalloni illustre bien ce phénomène. Les chercheurs ont demandé à des participants d’exprimer leur opinion sur le président français, puis sur les Américains. Ensuite, les participants ont discuté de ces sujets en groupe.
Après la discussion, les opinions des participants sont devenues plus extrêmes. Ceux qui avaient initialement une opinion légèrement favorable à l’égard du président français sont devenus encore plus positifs. Ceux qui étaient légèrement négatifs à l’égard des Américains ont renforcé leurs critiques. L’étude montre que le consensus du groupe peut pousser les individus à adopter des positions plus tranchées, car voir ses idées partagées par d’autres renforce la confiance en ses propres convictions.
L’effet de l’entourage sur nos croyances
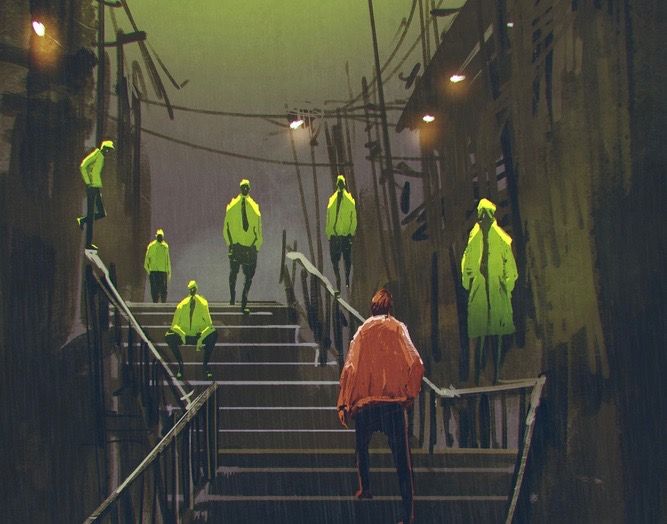
Nous avons également tendance à rechercher la compagnie de personnes partageant nos convictions. Une expérience menée sur des participants provenant de villes aux orientations politiques différentes — Boulder, majoritairement progressiste, et Colorado Springs, majoritairement conservatrice — a montré que les discussions sur des sujets controversés tels que le mariage homosexuel, la discrimination positive ou le changement climatique renforçaient les opinions de chaque groupe.
En d’autres termes, nos croyances deviennent plus rigides lorsque nous sommes entourés de personnes qui pensent comme nous. Cela peut expliquer pourquoi certaines communautés ou réseaux sociaux créent des « bulles idéologiques », où les opinions minoritaires sont rarement entendues.
Exemples dans la vie quotidienne
- Dans le milieu professionnel, les décisions de groupe peuvent mener à ce qu’on appelle la « pensée de groupe », où le désir d’harmonie prime sur le jugement critique. Cela peut expliquer pourquoi des projets ou des idées parfois risqués sont adoptés collectivement.
- Dans le domaine politique, les réunions ou discussions entre personnes partageant les mêmes idées peuvent renforcer les convictions et radicaliser les opinions.
- Même dans des situations simples comme choisir un restaurant ou un film, les gens sont souvent influencés par les choix de leurs amis ou de la majorité, même si leur préférence initiale diffère.
La psychologie sociale montre que nous ne sommes pas des êtres entièrement rationnels et indépendants. Les autres ont un pouvoir invisible mais réel sur nos croyances et nos comportements. Comprendre ces mécanismes peut nous aider à mieux réfléchir, à éviter les décisions impulsives et à reconnaître quand nos opinions sont influencées par le groupe plutôt que par notre propre jugement.
Si les autres le font, c’est que c’est bien ?
La plupart d’entre nous utilisons un raccourci mental pour décider quoi faire, penser, dire ou acheter : le principe de la preuve sociale. Pour déterminer ce qui est correct, nous observons ce que font les autres.
Le psychologue Robert Cialdini explique dans son ouvrage Influence : La psychologie de la persuasion : « Que la question soit de savoir quoi faire d’une boîte de pop-corn vide au cinéma, à quelle vitesse rouler sur un certain tronçon d’autoroute ou comment manger du poulet lors d’un dîner, les actions de ceux qui nous entourent seront importantes pour définir la réponse. » En d’autres termes, nous utilisons les comportements d’autrui comme guide pour nos propres actions.
La preuve sociale peut parfois jouer contre nous

Cialdini a étudié comment ce principe pouvait avoir des effets inattendus. Un exemple célèbre se trouve dans le parc national de la Forêt pétrifiée, en Arizona. Les visiteurs étaient accueillis par un panneau indiquant : « Votre patrimoine est vandalisé chaque jour par des vols de bois pétrifié de 14 tonnes par an, la plupart du temps par petits morceaux. »
Une expérience a montré que le sentier sans ce panneau enregistrait un tiers de vols en moins que le sentier avec panneau. Les visiteurs avaient interprété le message comme une autorisation implicite : si d’autres prennent des morceaux, cela semble « normal ». Ce phénomène illustre que la preuve sociale peut parfois encourager des comportements indésirables.
La preuve sociale peut aussi aider
Le principe de la preuve sociale peut être utilisé positivement, notamment pour surmonter des peurs ou modifier des comportements.
Une étude menée par Albert Bandura a travaillé avec des enfants ayant peur des chiens. Les enfants ont observé un garçon de quatre ans jouer joyeusement avec un chien pendant 20 minutes par jour sur quatre jours. Après cette période, 67 % des enfants étaient prêts à entrer dans un parc avec un chien, et un mois plus tard, beaucoup jouaient eux-mêmes avec des chiens. Observer le comportement positif d’un pair a servi de modèle et a réduit leur peur.
Des exemples dans la vie quotidienne
- Dans les files d’attente, les gens adoptent souvent le comportement du groupe : si tout le monde se met dans une certaine file, nous faisons de même sans y réfléchir.
- Dans le marketing, les entreprises exploitent la preuve sociale en montrant que leurs produits sont très populaires : avis clients, nombre d’achats, photos de célébrités utilisant le produit… cela incite les consommateurs à suivre la foule.
- Dans le domaine de l’environnement, certaines campagnes incitent les gens à recycler en indiquant le pourcentage de voisins qui le font déjà, encourageant ainsi un comportement positif.
Pourquoi les autres nous influencent-ils autant ?
Il est clair que les autres ont un impact considérable sur notre comportement. Mais pourquoi leur influence est-elle si puissante ? La réponse réside dans la complexité de notre environnement et dans notre nature profondément sociale.
La complexité du monde et les raccourcis mentaux
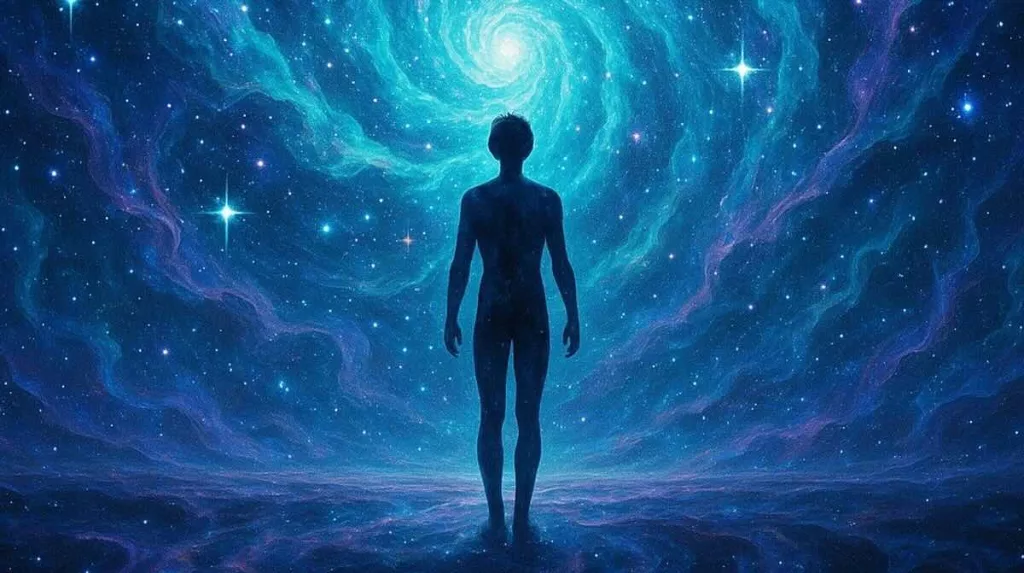
Nous vivons dans un monde très complexe et saturé d’informations. Pour naviguer efficacement, nous utilisons souvent les décisions d’autrui comme une heuristique, c’est-à-dire un raccourci mental.
Le philosophe et mathématicien anglais Alfred North Whitehead disait : « La civilisation progresse en augmentant le nombre d’opérations que nous pouvons effectuer sans y penser. » En d’autres termes, suivre les autres nous permet de prendre des décisions rapidement sans tout analyser en détail.
Robert Cialdini, dans son ouvrage Influence, donne l’exemple des annonceurs qui signalent qu’un produit est « le plus vendu » ou « celui qui connaît la plus forte croissance ». Les annonceurs n’ont pas besoin de prouver la qualité du produit : il suffit de montrer que beaucoup d’autres le choisissent. Cela fonctionne comme une règle simple : si quelque chose est populaire, c’est probablement une bonne option.
Dans la vie quotidienne, ce mécanisme se retrouve partout : choisir un restaurant très fréquenté, acheter un film qui a reçu de nombreuses critiques positives ou suivre les tendances vestimentaires. Tous ces comportements reposent sur le même principe : la popularité comme signal de qualité.
L’être humain, un animal social
Une autre raison de notre sensibilité à l’influence sociale est que les humains sont des êtres profondément sociaux. La survie de nos ancêtres dépendait de leur capacité à former des groupes. Ceux qui s’intégraient mieux dans leur communauté avaient plus de chances de survivre.
Comme le souligne Julia Coultas, chercheuse à l’Université d’Essex : « Pour un individu rejoignant un groupe, copier le comportement de la majorité serait alors un comportement judicieux et adaptatif. Une tendance au conformisme faciliterait l’acceptation au sein du groupe et pourrait assurer la survie, par exemple en imitant les choix alimentaires de la majorité. »
Au fil de l’évolution, cette conscience aiguë d’autrui a façonné notre psychologie. Être ostracisé dans un groupe de chasseurs-cueilleurs pouvait signifier la mort, car la coopération et l’harmonie sociale étaient essentielles pour la survie. Cette nécessité de se conformer à un certain degré a laissé une empreinte durable sur notre comportement moderne.
Exemples contemporains d’influence sociale
- Dans le milieu professionnel, un employé peut adopter les pratiques de ses collègues pour s’intégrer rapidement, même s’il aurait choisi autrement de manière isolée.
- Dans la sphère en ligne, les réseaux sociaux amplifient l’influence du groupe : likes, partages et commentaires créent un effet de norme sociale qui guide nos opinions et comportements.
- Dans l’éducation, les jeunes élèves imitent souvent les comportements des camarades populaires pour être acceptés dans le groupe, qu’il s’agisse de vêtements, d’activités ou de choix de loisirs.
Comprendre pour mieux agir
Réfléchir à l’influence sociale nous aide à mieux comprendre nos décisions et nos interactions avec les autres. Être conscient de ces mécanismes permet de choisir quand suivre la foule et quand prendre du recul pour adopter un comportement autonome.
Reconnaître l’impact de notre environnement social peut également nous aider à créer des environnements positifs, où les comportements bénéfiques — comme l’entraide, le respect ou la coopération — deviennent la norme.
Conclusion
La preuve sociale montre à quel point nos comportements sont influencés par ceux des autres. Elle peut nous pousser à adopter des comportements indésirables, mais elle peut aussi être utilisée pour encourager des actions positives. Comprendre ce mécanisme nous permet de mieux réfléchir à nos décisions et d’utiliser l’influence sociale à notre avantage.
Références
Bandura, A., Grusec, JE, et Menlove, FL (1967). Extinction vicariant du comportement d’évitement. Journal of Personality and Social Psychology, 5(1), 16-23. doi:10.1037/h0024182
Cialdini, RB (2003). Élaborer des messages normatifs pour protéger l’environnement. Orientations actuelles en psychologie scientifique, 12(4), 105-109.
Cialdini, R. (2007). Influence : la psychologie de la persuasion (éd. rév. ; 1re éd. Collins Business Essentials). New York : Collins.
Coultas, JC (2004). À Rome… Une perspective évolutionniste sur la conformité. Processus de groupe et relations intergroupes, 7(4), 317-331. doi:10.1177/1368430204046141
Lee, D., et Hatesohl, D. (sd). L’écoute : notre compétence de communication la plus utilisée. Consulté le 8 septembre 2014.
Moscovici, S., et Zavalloni, M. (1969). Le groupe comme polarisateur d’attitudes. Journal of Personality and Social Psychology, 12(2), 125-135. doi:10.1037/h0027568
Schkade, D., Sunstein, CR, et Hastie, R. (2007). Que s’est-il passé le jour de la délibération ?. California Law Review, 95(3), 915-940.

