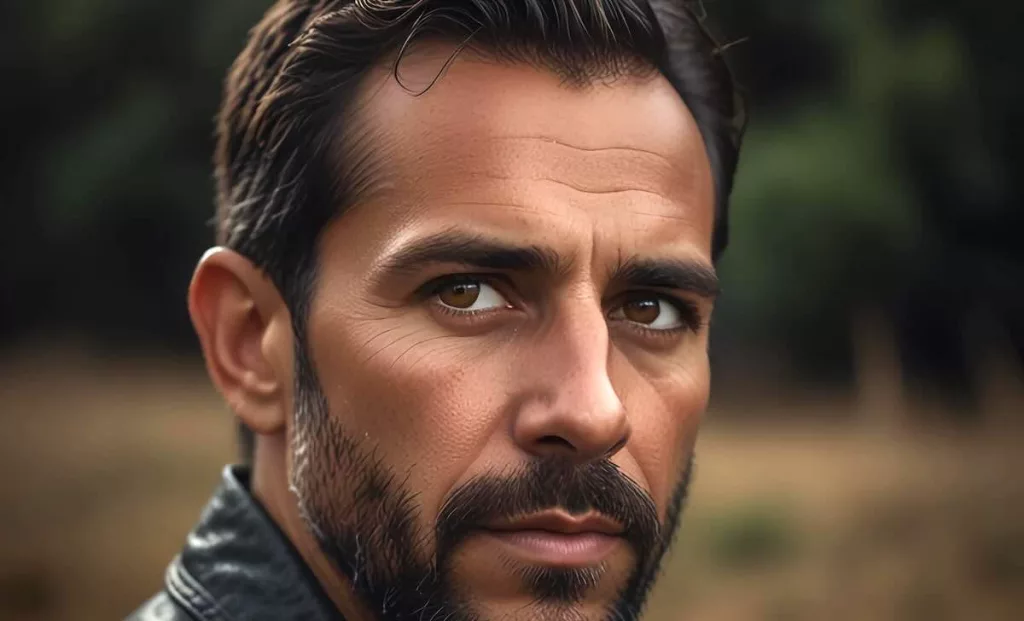
Ma dépression nerveuse : un chemin inattendu
Il y a cinq ans, j’ai traversé une période difficile marquée par une anxiété sévère, qui s’est imposée de manière brutale et inattendue. Jusqu’à mes vingt-sept ans, je me considérais comme une personne en parfaite santé. Je ne tombais jamais malade, je pouvais jouer au basket pendant six heures d’affilée et je me sentais toujours plein d’énergie. Mais tout a basculé en 2020.
Un matin, je me suis réveillé avec une démangeaison sur la poitrine. En baissant les yeux, j’ai découvert deux petites marques ressemblant à des crocs : une morsure d’araignée. Quelques minutes plus tard, les toxines ont commencé à agir, provoquant de légères convulsions. Mon père m’a alors emmené aux urgences.
Une expérience traumatisante
Aux urgences, on m’a administré une injection de stéroïdes dans les fesses ainsi que des antibiotiques pour prévenir une infection. Ce sont des souvenirs marquants, mais aussi très difficiles à oublier.
Pour faire court, cette expérience m’a profondément bouleversé. J’ai développé une anxiété sévère liée à ma santé, une inquiétude constante quant à ce qui pourrait arriver. J’avais peur de m’endormir, incapable de me sentir en sécurité. On me voyait trembler, visiblement paniqué, dans mon lit.
Les morsures d’araignées sont rares, n’est-ce pas ? Je pensais ne pas avoir de raison de m’en inquiéter. Mais quelques jours plus tard, une autre araignée m’a mordu ! Heureusement, mon corps n’a pas réagi aussi violemment la deuxième fois, mais cette nouvelle morsure a renforcé ma paranoïa.
La pente glissante de l’anxiété

Rapidement, je suis passée du calme à une anxiété intense. C’était une descente étrange et inattendue : inquiétude, insomnies, peur de dormir et crises de panique. En même temps, j’espérais de tout cœur que tout redevienne comme avant. Je n’avais jamais autant espéré quelque chose dans ma vie.
Le côté obscur de l’espoir
L’espoir, bien que souvent considéré comme une lumière dans l’obscurité, possède un côté sombre quant à son influence sur notre esprit.
C’est un désir puissant que quelque chose se réalise : vaincre l’anxiété ou la dépression, intégrer l’université de ses rêves, trouver l’amour, résoudre un problème lourd à porter, ou même voir son équipe favorite remporter enfin une victoire.
Mais l’espoir peut devenir une prison mentale, par son intensité et le contrôle qu’il exerce sur nos pensées.
Lâcher prise : une voie vers la liberté
J’ai beaucoup étudié le marché du développement personnel, et un thème revient souvent dans les ouvrages les plus populaires : le lâcher prise. Lorsque j’ai regardé les 20 livres les plus vendus dans ce domaine, nombreux étaient ceux qui parlaient de lâcher prise, que ce soit sur des pensées, des émotions, ou des attentes.
Lâcher prise sur ce qui envahit notre esprit, y compris l’espoir, peut nous libérer instantanément. Cela nous ouvre à d’autres réalités : la douceur d’une brise, la beauté d’une amitié sincère, la simplicité d’un repas partagé. Ces petites joies de la vie passent souvent inaperçues lorsque nos préoccupations prennent toute la place.
Pourquoi abandonner l’espoir peut-il libérer ?

L’espoir est généralement perçu comme une force positive. Alors, pourquoi son abandon serait-il source de liberté plutôt que d’obscurité ? Cette question demeure au cœur de ma réflexion.
J’ai réussi à sortir de ma spirale infernale parce que j’avais perdu tout espoir. Rien d’autre n’a fonctionné.
Au plus fort de la lutte, j’espérais désespérément que les choses redeviennent normales. Plus la situation empirait, plus mon espoir grandissait. Pourquoi ce cauchemar ne pouvait-il pas prendre fin ? J’espérais que ma prochaine inspiration serait longue, profonde et apaisante, mais elle ne l’était jamais. J’espérais pouvoir remonter le temps pour arracher les crochets de cette araignée. J’espérais et je tentais de changer, sans succès.
Espérer, une attente incertaine
Espérer, c’est une forme atténuée d’attente. Quand on attend quelque chose, on est presque sûr que cela arrivera. Quand on espère, on ne sait pas si cela se produira, mais on aimerait que ce soit le cas.
L’espoir devient dangereux lorsqu’il nous pousse à mener une bataille que nous ne pouvons pas gagner.
Dans mon cas, je pouvais en théorie me détendre et « surmonter ça ». J’ai alors agi comme on le fait instinctivement : j’ai tout donné. J’ai essayé de contrôler ma respiration, mais cela s’est retourné contre moi, car je suis devenu hyperconscient de chaque souffle. Cela a aggravé la situation.
Mon espoir m’a poussé à lutter sans relâche, alors que ce n’était pas ce que je devais faire.
Savoir quand battre en retraite

Dans la vie, comme à la guerre, il faut savoir quand attaquer et, tout aussi important, quand battre en retraite. Tous les ennemis ne se vainquent pas par des méthodes simples et conventionnelles.
Je me souviens du jour où j’ai volontairement perdu espoir et « abandonné ». J’étais dans la cuisine, angoissé sans raison, et j’en avais assez de ce combat. J’ai décidé de lâcher prise. J’avais perdu tout espoir de gagner. À ma grande surprise, avec le temps, l’ennemi s’est éloigné.
Changer de comportement grâce à la perte d’espoir
Voici comment j’ai changé mon comportement lorsque j’ai perdu espoir : j’ai cessé d’essayer (et d’espérer) ne plus avoir des papillons dans le ventre sans raison. J’ai arrêté de me soucier de la fréquence et de la profondeur de ma respiration. J’ai même commencé à « jouer » avec mon problème, montrant que je m’en fichais : « Seulement cinq papillons cette fois ? C’est tout ? Donne-m’en encore quelques-uns ! »
Perdre espoir m’a fait arrêter de combattre. C’est ainsi que j’ai gagné la guerre et retrouvé ma liberté mentale.
Une leçon ancienne confirmée par la science
Je sais que cette histoire semble aussi inspirante que celle de Braveheart, mais ce concept a été illustré ailleurs.
Un jour, le frère du romancier Léon Tolstoï lui dit de s’asseoir dans un coin jusqu’à ce qu’il cesse de penser à un ours blanc. Plus tard, Tolstoï resta dans son coin, l’esprit fixé sur l’ours blanc qu’il devait oublier. Ce n’est qu’une fois autorisé par son frère qu’il put enfin cesser d’y penser.
Cette expérience a été reproduite à maintes reprises, et le résultat est toujours le même : lorsque les gens s’interdisent de penser à quelque chose, cette pensée leur revient en boomerang, avec une constance et une persistance alarmantes.
Des études montrent que plus on essaie de réprimer des pensées négatives, plus on risque de sombrer dans la dépression. (Kelly McGonigal, Ph.D., L’instinct de volonté)
L’espoir, moteur de persévérance… mais parfois un piège

L’espoir engendre la persévérance, c’est pourquoi perdre espoir dans un domaine qui nécessite un retrait est souvent synonyme de liberté.
Faire plus d’efforts ne garantit pas toujours de meilleurs résultats. En revanche, adopter des stratégies plus intelligentes produit toujours de meilleurs effets.
Et vous, où luttez-vous sans avancer ?
Pensez à un domaine de votre vie où vous essayez, luttez et espérez sans progresser. À quoi ressemblerait le fait de perdre espoir et de lâcher prise ?
Cette approche est particulièrement utile face à l’anxiété, à l’inquiétude, à la peur ou à la dépression. En les acceptant et en cessant d’espérer leur disparition immédiate, ils perdent une grande partie de leur pouvoir sur vous.
Pour moi, perdre espoir a été synonyme de liberté. Peut-être le sera-t-il aussi pour vous.

