
L’approche absurde de l’an 2025
Alors que je suis assis ici, contemplant le fait que nous sommes dans l’an de grâce 2025, une lassitude profonde s’installe en moi, sur ce corps vieillissant. Peut-être avons-nous le quart de siècle, mais l’idée même de « 2025 » — vingt-cinq ! — semble absurde.
Il est impossible que cette année soit réelle, qu’elle se déroule en temps réel. C’est un chiffre tout droit sorti des contes de voyage dans le temps, des films projetant un futur spatial, des romans dystopiques dressant le portrait d’une société en ruine. Cela ne peut pas être maintenant.
Et pourtant, le calendrier ne ment pas. 2025 est là, que je le croie ou non.
Une perception du temps qui se dérègle
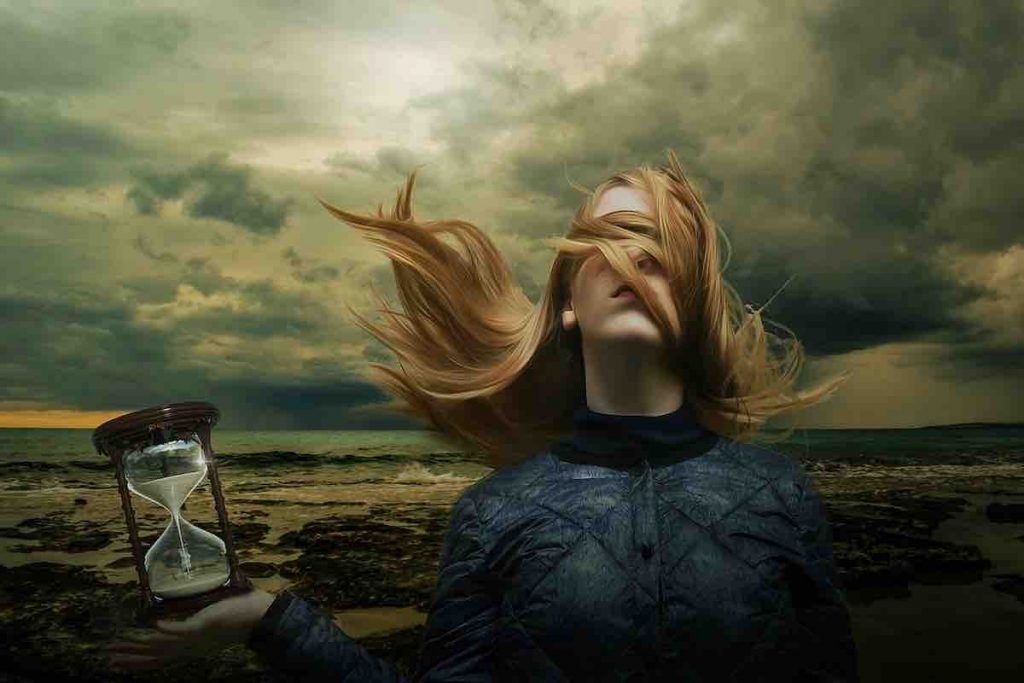
Le temps semble nous jouer des tours. La pandémie, n’était-ce pas il y a tout juste deux ans ? Les Jeux olympiques de Paris, il y a un ans, non ? Et le passage au millénaire… il y a dix ans, tout au plus — j’en suis certaine.
Je ne suis pas seule à ressentir cette impression vertigineuse que les années défilent de plus en plus vite avec l’âge.
Une illusion que la science confirme
Albert Einstein a popularisé l’idée que le temps est relatif : une heure passée avec quelqu’un que l’on aime s’écoule en un instant, tandis qu’une minute sur une plaque chauffante paraît une éternité.
Mais au-delà de la métaphore, la science confirme que notre perception du temps s’accélère avec l’âge. Une étude récente de l’Université John Moores de Liverpool révèle par exemple que la grande majorité des Britanniques ont l’impression que Noël arrive de plus en plus vite chaque année. De même, en Irak, beaucoup ressentent que le Ramadan survient toujours plus tôt.
« Le temps physique n’est pas le temps de l’esprit », explique Adrian Bejan, professeur de génie mécanique et auteur de Time and Beauty: Why Time Flies And Beauty Never Dies. « Le temps que vous percevez n’est pas le même que celui perçu par autrui. »
Le cerveau, moteur de notre horloge intérieure
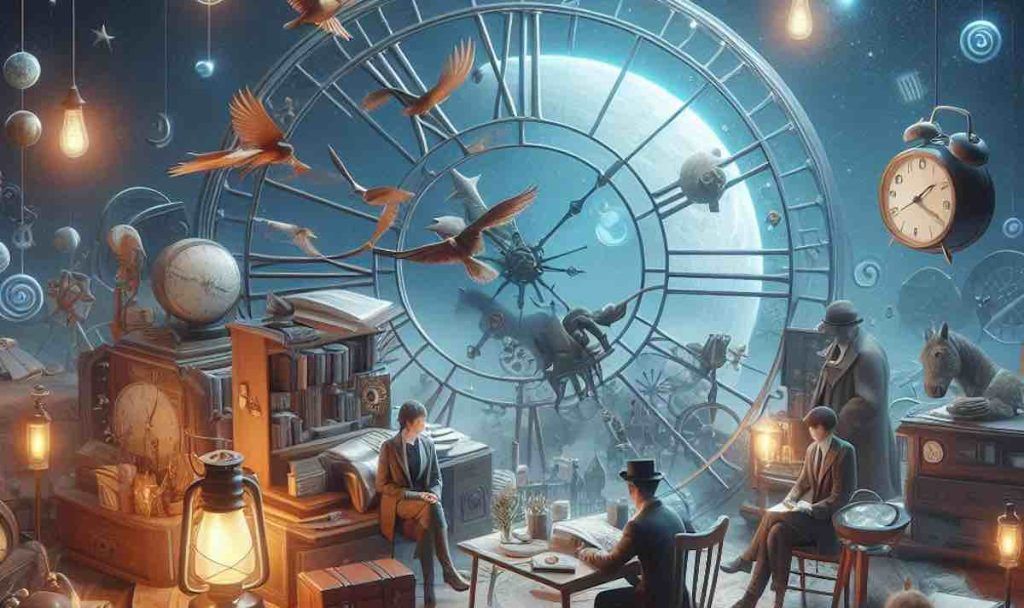
Cette distorsion temporelle trouve une part de son explication dans la physiologie du cerveau. Vous souvenez-vous, enfant, de ces vacances d’été qui semblaient infinies, comme un chewing-gum que l’on étire sans fin lors d’après-midis paisibles ?
Il existe une réelle base scientifique à cette sensation.
Selon Bejan, notre cerveau reçoit moins d’images qu’il n’en recevait durant l’enfance. Il avance l’hypothèse que la vitesse de traitement de l’information visuelle ralentit avec l’âge. À mesure que la taille et la complexité des réseaux neuronaux augmentent, les signaux électriques doivent parcourir de plus longues distances, ce qui freine leur circulation.
Résultat : nous percevons moins d’« images par seconde ». Et moins il y a d’images, plus le film de notre vie semble défiler rapidement.
C’est un peu comme un folioscope : plus les images sont espacées, plus on arrive vite à la fin.
Des souvenirs d’éternité
« Les gens sont souvent étonnés de constater à quel point ils se souviennent de ces journées qui semblaient durer une éternité dans leur jeunesse », observe Adrian Bejan. « Ce n’est pas que leurs expériences étaient plus profondes ou plus significatives, mais qu’elles étaient simplement traitées à un rythme effréné. »
Plus nous sommes jeunes, plus notre cerveau enregistre d’informations à grande vitesse, ce qui rend chaque moment riche, dense, et plus long dans notre mémoire.
Il y a aussi une logique mathématique simple. Moins nous avons vécu, plus une période donnée occupe une place importante dans notre existence. Pour un enfant de quatre ans, une année représente 25 % de sa vie. Pour une personne de 40 ans, ce n’est qu’un quarantième. Il n’est donc pas étonnant qu’elle paraisse plus brève, moins marquante.
Même si nous ne pouvons pas agir sur ces mécanismes physiologiques, d’autres facteurs — eux — sont sous notre contrôle.
Le rôle des premières fois

Une autre raison pour laquelle le temps semble plus long dans l’enfance, c’est que le cerveau est programmé pour accorder une attention particulière aux nouvelles expériences. Et dans les premières années de la vie, tout ou presque est une découverte : apprendre à marcher, parler, aller à l’école, nouer des amitiés, comprendre les règles du monde.
Chaque jour est rempli d’inédit. Le cerveau est alors saturé de nouveautés à absorber et à organiser.
L’ennui de la répétition
Mais en vieillissant, les nouveautés se raréfient. D’une part, parce que nous avons déjà expérimenté beaucoup de choses. D’autre part, parce que nous avons tendance à rechercher le confort du familier. La routine s’installe, les habitudes se figent. Même goûter un nouveau plat peut sembler excessif.
Et lorsque la vie devient répétitive, elle ne laisse que peu de souvenirs marquants. Les semaines se fondent en mois, les mois en années. Rien ne distingue un jour d’un autre. Le temps, dès lors, semble s’accélérer.
Créer des souvenirs pour ralentir le temps
À l’inverse, les périodes les plus riches en événements laissent l’impression qu’elles ont duré plus longtemps. « Nous avons l’impression que le temps s’étire… et paraît très long », explique Cindy Lustig, professeure de psychologie à l’Université du Michigan.
Lorsque nous créons peu de souvenirs nouveaux, nous avons peu d’éléments auxquels raccrocher notre perception du temps. Mais en introduisant de la variété, des surprises, du changement, nous enrichissons notre mémoire — et nous donnons l’illusion que le temps ralentit.
Sortir de la routine
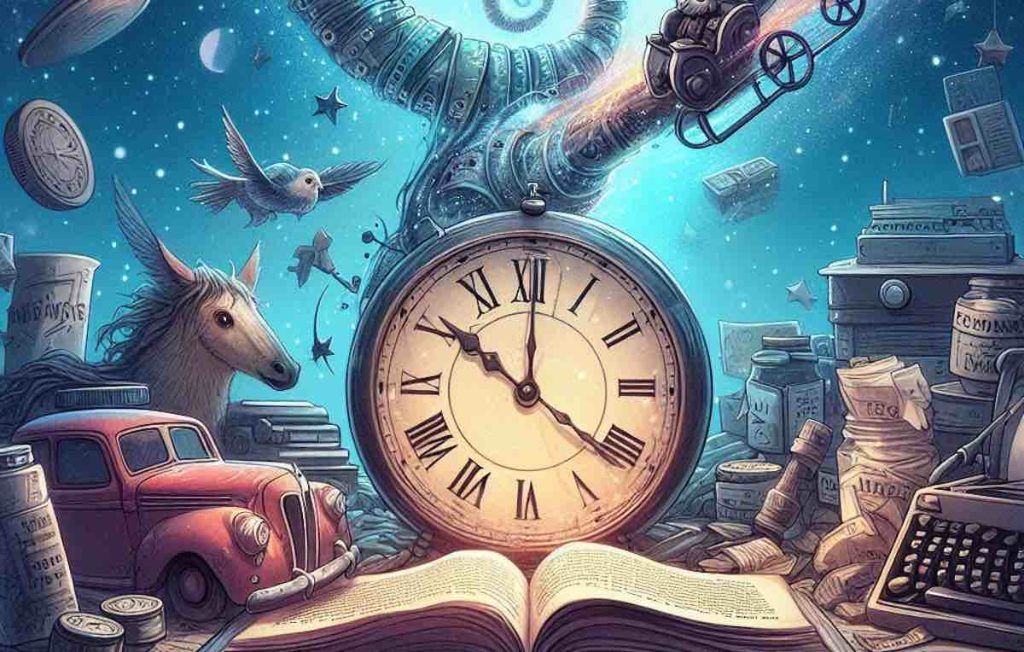
La routine est l’ennemie de la lenteur du temps. Il n’est pas nécessaire de tout bouleverser : marcher par un itinéraire différent, découvrir un nouveau passe-temps, écouter un genre musical inhabituel… Chaque petite nouveauté devient une ancre dans notre mémoire.
« Ralentissez un peu, forcez-vous à faire de nouvelles choses pour sortir de la routine », conseille Bejan. « Offrez-vous des surprises. Faites des choses inhabituelles. Vous avez entendu une bonne blague ? Racontez-la. Vous avez une idée ? Mettez-la en œuvre. Créez. Dites quelque chose. »
L’importance d’être pleinement présent
Et puis, il y a ce mot parfois galvaudé : pleine conscience. Si le temps est une question de perception, alors cultiver une attention consciente à l’instant présent devient essentiel.
Être pleinement là, dans ce que l’on fait, permet d’en tirer davantage. Non seulement on vit plus intensément, mais on ancre aussi mieux ses souvenirs. « Personne ne sait combien de temps il nous reste à vivre, mais il est intéressant de noter que nous avons un grand contrôle sur la manière dont nous vivons ce temps », rappelle Lustig.
En ressassant sans fin les erreurs passées ou en s’angoissant pour un avenir incertain, on néglige souvent la seule chose qui soit réellement entre nos mains : ici, maintenant.

